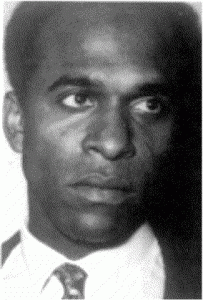À propos du dossier « Frantz Fanon, 50 ans après… Une vie, une pensée de révolutionnaire », Contretemps, n° 10, juin 2011
« Oubli », ce mot ne cesse de revenir sur les lèvres à la veille de la commémoration du cinquantième anniversaire de la mort du psychiatre, révolutionnaire et théoricien des décolonisations Frantz Fanon, décédé le 6 décembre 1961, à l’âge de 36 ans, des suites d’une leucémie. De cet « oubli », il est sans surprise question dès l’introduction à l’excellent dossier que la revue Contretemps — avant sans aucun doute beaucoup d’autres — consacre, dans son numéro de juin 2011, à la figure de Fanon. Ce dont il s’agit alors, c’est de réparer cet oubli, de « se souvenir de Fanon » pour reprendre le titre de l’introduction que Homi K. Bhabha rédigea dès 1986 pour la réédition anglaise de Peau noire, masques blancs [1], texte qui fut la source de toute une tradition critique (les Fanon studies) demeurant largement méconnue dans les champs académiques et militant francophones. Que peut-il dès lors y avoir de plus approprié qu’une commémoration pour mettre fin à cet oubli, pour se remémorer Fanon ?
Sans aucun doute, cet anniversaire sera l’occasion, à ne pas manquer, de réintroduire Fanon dans les débats politiques et intellectuels qui agitent notre époque, notre situation postcoloniale. Mais nous n’en pensons pas moins que pour qu’un authentique « retour de Fanon » soit possible, pour qu’il soit plus qu’un feu de paille, il faut avant toute autre chose commencer par s’interroger sur la signification de l’oubli dont il a fait l’objet. Car la grande erreur serait de confondre cet oubli avec une pure et simple absence, un manque, un vide qu’il s’agirait de combler. Le danger, c’est de maintenir — à dessein ou non — l’illusion qu’absolument rien n’a été dit de Fanon et que la tâche qui s’offre à nous est uniquement de restituer son œuvre, pour ainsi dire dans sa « nudité » dans la mesure où elle demeurerait encore vierge de toute interprétation. Il y a, d’un point de vue intellectuel, quelque chose de très confortable dans cette conception de l’« oubli de Fanon ». Elle permet en effet de s’épargner l’effort d’un véritable engagement envers son œuvre puisqu’il ne s’agit jamais que d’en appeler avec véhémence à la (re)découverte des textes de Fanon… sans pour autant véritablement débuter cette tâche elle-même ; et l’effet est en quelque sorte garanti par avance par le seul fait d’affirmer que la figure de Fanon a trop longtemps été voilée et qu’il est devenu de première urgence de la dévoiler. Cela est d’autant plus problématique que cette affirmation fait l’objet d’une répétition indéfinie, comme s’il fallait à chaque fois recommencer… à partir de rien. C’est en quelque sorte comme si l’oubli était la condition de possibilité même de ce discours, ou mieux, comme si ce discours générait lui-même l’oubli auquel il s’oppose, ceci autorisant son incessante reproduction. Fanon risque alors de ne devenir guère plus que l’objet de célébrations inconditionnelles… et souvent stériles.
Ceci étant dit, cela ne signifie aucunement que l’oubli de Fanon soit une pure et simple fiction, dont certains useraient consciemment et à de trop évidentes fins stratégiques. C’est par conséquent la nature même de cet oubli qu’il faut élucider, un oubli qui pour ainsi dire ne cesse d’être oublié. Or, c’est le grand mérite du dossier que nous livre la revue Contretemps que d’entendre en découdre avec cet oubli sans pour autant tomber dans le piège de la prétention à la révélation. Car ce que montrent Félix Boggio Éwanjé-Épée, Rafik Chekkat et Stella Magliani-Belkacem, dès l’introduction de ce dossier, c’est que l’oubli de Fanon est indissociable de ses retours et réhabilitations : « Le chemin de Fanon jusqu’à nous est fait d’histoires d’oubli et de restitution [2] . » Réhabilitation tout d’abord à la faveur des congrès de Fort-de-France (1982), Brazzaville (1984) et Alger (1987) [3]. Réhabilitation académique ensuite dans le monde anglo-saxon avec l’intronisation de Fanon au panthéon des grands théoriciens postcoloniaux. Réhabilitation enfin beaucoup plus tardive en France puisqu’elle aura attendu la publication du Portrait de Fanon d’Alice Cherki (2000) suivie, entre autres, par la publication d’un dossier (« Pour Frantz Fanon ») dans Les Temps modernes (2006) et l’organisation d’un colloque (« Penser aujourd’hui à partir de Frantz Fanon ») à l’Unesco à Paris (2007).
Comment se fait-il dès lors que, tant en France que dans ses (ex-)colonies (à la différence des États-Unis et du Royaume-Uni), n’ait pu se constituer un socle commun d’interprétations — fût-il étroit —, un champ théorique et politique – fût-il encore partiellement en friche —autour de la figure de Fanon. Comment se fait-il que « tout en se souvenant de Fanon, on ne cesse de l’oublier [4] » ? Comment se fait-il qu’il faille toujours re-découvrir Fanon ? Comment se fait-il que malgré tout ce qui a été dit sur lui, l’on ne puisse manquer d’avoir encore le sentiment que, ainsi que Sartre l’écrivait en 1963, « sur Fanon, tout reste à dire [5] » ? Pourquoi ces répétitions ? Pourquoi ce cercle ? Pourquoi en somme l’oubli ne passe pas ? Pourquoi le souvenir demeure inefficient ? C’est très certainement que le destin « francophone » de l’œuvre de Fanon est intimement lié à la situation postcoloniale qui est celle de la France comme celle de ses (ex-)colonies. Ce destin est étroitement dépendant du « passé » colonial, un passé qui ne passe pas, qui ne cesse de faire retour, de se répéter/régénérer en empruntant une variété de masques ; un passé qu’il faut sans cesse dévoiler afin de vaincre les puissantes forces d’oubli qui tendent à le recouvrir d’un épais voile : « En France, Fanon est aussitôt oublié. Un peu comme un souvenir traumatique. Fanon est évacué tant il rappelle tout ce que la France préférerait occulter. L’Algérie, de son côté, oublie un peu vite Fanon : non pas pour ce qu’il retient mais parce qu’il est l’annonciateur des lendemains difficiles [6]. » Si d’autres figures de l’anticolonialisme — ne pensons ici qu’à Aimé Césaire — ont pu récemment bénéficier d’une plus large réception que Fanon, c’est probablement parce que leur engagement politique n’atteignait pas l’intransigeance, et pour tout dire la violence, de celui d’un Fanon qui, ne l’oublions pas, en appelait à une rupture totale avec l’Europe, condition d’une authentique décolonisation.
Si le dossier de la revue Contretemps nous intéresse, c’est qu’il prend acte de ce singulier oubli et l’affronte dans toute sa complexité. Refusant, nous l’avons dit, de jouer la carte de la découverte ex-nihilo de Fanon, ses auteurs entendent avant tout produire une série d’analyses et d’interprétations devant autoriser une réinscription politique/académique de Fanon à long terme, plutôt que de se livrer à une énième hagiographie. Ne soulignons que quelques « temps forts » des articles qui composent ce dossier. Il était ainsi essentiel de rappeler, comme le font les auteurs de l’introduction, que « Fanon, c’est avant tout une écriture – et plus qu’un verbe, c’est un souffle [7] » ; car il ne faut jamais oublier que ce « souffle » de la parole est déjà résistance face à l’oppression, celle-ci devant aussi être conçue physiologiquement, ainsi que Fanon le fait lui-même, comme « difficulté à respirer [8] » ; il ne faut jamais oublier que l’écriture de Fanon est fondamentalement incarnée, que c’est pour lui le corps — en particulier lorsqu’il est stigmatisée/racialisée — qui donne sens, autrement dit qu’il y a un discours des sens qui seul peut révéler le non-sens du discours du racisme colonial. Il était également pour le moins important de clarifier la position de Fanon à l’égard de la « terreur révolutionnaire » et de la violence destructrice des luttes anticoloniales, ainsi que le fait Léo Zeilig dans sa contribution [9]. On saluera également l’effort de Rafik Chekkat qui s’est attaché à dévoiler le lien — parfois ambiguë mais ô combien capital — qui unit chez Fanon expérience subjective du racisme et racisme structurel (« objectif »), Ckekkat ne craignant pas par ailleurs de souligner les limites de Fanon, notamment lorsque celui-ci, dans ses premiers écrits, « montre à plusieurs reprises n’avoir que très peu de connaissances des luttes des esclaves pour se libérer [10] », en particulier des luttes des esclaves antillais. Enfin et de notre point de vue, la pièce maîtresse de ce dossier est l’article de Peter Hallward — auquel on ne saurait rendre justice en quelques mots — qui révèle un concept central dans l’œuvre de Fanon, celui de volonté (populaire/politique). Et là encore il est question d’oubli… : « Il s’agit aussi du concept qui a été le plus minutieusement oublié, sinon réprimé, en théorie comme en pratique, par le champ qui, ces dernières décennies, s’est largement approprié l’héritage de Fanon : celui des études postcoloniales. Tout “retour à Fanon“ digne de ce nom doit inclure comme étape préliminaire, l’oubli de cet oubli [11] . » Ce qu’il s’agit d’interpréter, de repenser, c’est le volontarisme de Fanon — en tant qu’il se distingue d’un pur et simple spontanéisme. Soulignons néanmoins qu’à nos yeux, c’est précisément parce qu’il y a dans le monde anglo-saxon un véritable héritage des études fanoniennes que la critique qu’en fait Hallward acquiert une telle force. C’est, pour pasticher Hegel, parce qu’elle s’oppose à toute une tradition d’interprétations (postcoloniales) que la thèse de Hallward se pose de manière si convaincante. Or, c’est d’une telle « tradition » dont nous manquons, les lectures postcoloniales de Fanon ne jouant souvent guère plus chez ses détracteurs francophones que le rôle d’épouvantail, d’ennemi imaginaire.
Comment alors commencer pour enfin mettre fin à l’oubli et faire de Fanon notre contemporain ? L’on ne répondra adéquatement à cette question qu’en tâchant tout d’abord de sortir de l’impasse que décrit très bien Léo Zeilig affirmant au sujet des interprétations de Fanon : « Dans beaucoup d’études l’accent est mis sur son écriture et sa philosophie aux dépens du contexte ou, au contraire, des éléments contextuels sans aucun lien avec la pensée de Fanon [12] . » L’on ne peut que souscrire à ce constat. Quoique l’orientation de nos propres recherches soit très différente de celle des recherches que conduit Zeilig, nous avons nous aussi récemment déploré l’exclusivité du penchant biographique qui mine les lectures francophones de Fanon en ne cessant d’ajourner un véritable engagement envers sa pensée, mais avons aussi indiqué les limites d’une interprétation théorique décontextualisée et déshistoricisée [13] . Nous nous sommes alors attachés à dresser un « portrait théorique en situation » fondé sur l’« archive intellectuelle » effective de Fanon, mais soucieux également de déceler chez lui les commencements d’une critique postcoloniale au sein même de l’anticolonialisme [14], Amsterdam, Paris, 2011.]] . Il fallait selon nous aller au-delà de cette méfiance envers la « théorie », méfiance en vertu de laquelle certains défenseurs de Fanon en viennent finalement, et probablement contre leur gré, à rejoindre ses détracteurs, ceux qui pensent qu’en somme Fanon ne nous donne rien à penser. N’en disons pas plus et tâchons plutôt d’indiquer comment l’on pourrait aller encore un peu plus loin.
Là encore les auteurs de l’introduction du dossier nous indiquent la voie à suivre lorsqu’ils soulignent un oubli fondamental, « celui de l’unité de la théorie et de la pratique [15], p. 13.]] » dans l’œuvre et la vie de Fanon. Certes, Fanon n’est pas Lénine, et il ne faudrait pas s’attendre à trouver chez lui une théorisation de cette unité en tant que telle. Il n’en reste pas moins que celle-ci devrait être thématisée et pourrait l’être de plusieurs manières — non exclusives les unes des autres, tout au contraire. L’on pourrait tout d’abord s’efforcer de mettre au jour la pensée de Fanon en tant que philosophie de la praxis, ainsi que l’indique incidemment Léo Zeilig [16] . L’on pourrait également, et ainsi que nous le suggérait Sandro Mezzadra, s’efforcer de donner lieu, non plus tant à une biographie de l’homme Fanon qu’à une biographie de l’œuvre de Fanon ; alors la « biographie cesserait d’être confinée au champ de l’‘expérience’ et acquerrait elle-même une pertinence ‘théorique’ [17] ». Il existe enfin une troisième voie (il y en a probablement d’autres encore) sur laquelle nous nous attarderons plus longuement. Elle consisterait, à première vue curieusement, à réunifier la théorie et la pratique fanoniennes à partir de la notion de « voyage » (l’on pourrait également dire de « migration »).
En effet, la pratique théorique de Fanon peut être interprétée comme une pratique du déplacement des théories européennes. C’est une pratique gouvernée par un double mouvement de rupture et de reprise, de décentrement et de traduction des théories nées sur le sol européen, au-delà à la fois de toute exclusion et de tout mimétisme. Fanon fait voyager la « pensée européenne » au-delà de ses frontières pour la confronter à son Autre extra-européen, pour la mettre à l’épreuve de la situation coloniale en la retournant contre ses auteurs. Il s’agit, pour emprunter le concept d’Edward W. Said, de convertir ces théories en théories voyageuses [18] . Fanon engage à cet égard le projet d’une décolonisation des savoirs. Lire Fanon, c’est ainsi comprendre que le concept de « diaspora », telle qu’il a été développé dans les cultural et postcolonial studies — que l’on ne pense qu’à Stuart Hall et Paul Gilroy – pourrait être traduite épistémologiquement et ainsi caractériser les théories elles-mêmes, de telle manière qu’il faudrait désormais parler de théories en diaspora.
Quoi qu’il en soit, il serait à présent nécessaire d’expliciter le lien profond qui unit la pratique fanonienne du déplacement épistémique avec le parcours de ce théoricien voyageur — selon les mots de James Clifford — qu’est lui-même Fanon. Car la courte vie de ce dernier fut fait de voyages, de déplacements et d’allers-retours incessants, depuis son engagement dans les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à son ultime voyage aux États-Unis (ultime tentative pour essayer de soigner la maladie qui le rongeait), en passant bien évidemment par son expérience révolutionnaire auprès du Front de Libération Nationale algérien, qui le conduisit d’Algérie en Tunisie puis en Afrique sub-saharienne – en tant qu’ambassadeur du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne. L’on comprend sans peine que ce ne sont pas des voyages d’agrément que fit Fanon. Ses voyages dans l’espace impérial français furent à chaque fois de profondes expériences politiques — sans pour autant cesser d’être des expériences subjectives/existentielles — et eurent un essentiel rôle formateur en un sens que l’on pourrait dire quasi hégélien (comme bildung) [Rappelons à cet égard que Fanon conçoit le processus de désaliénation-émancipation comme un voyage phénoménologique de la conscience (dé)colonisée et qu’il le fait en traduisant/déplaçant la phénoménologie hégélienne, autrement dit en la faisant elle-même voyager au-delà du monde européen.]. C’est pourquoi il devient essentiel de comprendre le voyage fanonien des théories depuis la perspective même des voyages du théoricien Fanon, vaste tâche que l’on ne pouvait ici qu’encourager sans réellement l’engager.
Nous conclurons en revenant sur une question que nous avons jusqu’à présent volontairement passée sous silence alors qu’elle est au cœur de tout le dossier que la revue Contretemps dédie à Fanon : c’est la question des relations de Fanon au marxisme. Dès l’introduction du dossier, le nom de Fanon est mobilisé dans la mesure où il « pourrait en partie nous venir en aide pour régler un problème général de la gauche française avec les médiations [19] ». Léo Zeilig, lui, revient sur la critique fanonienne des bourgeoisies nationales ainsi que sur le privilège que Fanon, « sous l’influence des interprétations maoïstes du socialisme [20] » confère à la paysannerie sur les classes ouvrières. Mais Zeilig indique aussi les limites d’un projet qui révèle parfois une « confusion de marxisme, de maoïsme et de tactique de guérilla [21] ». Rafik Chekkat réactive pour sa part la question capitale, et pourtant souvent oubliée, des relations entre « conscience de race » et « conscience de classe » dans les écrits de Fanon. Peter Hallward enfin lit Fanon à la lumière de ses aînés que sont Lénine et Mao, les confronte à eux en le mettant sur un pied d’égalité, tout en regrettant par moment la logique militaire qui gouverne selon lui la compréhension fanonienne de l’oppression coloniale comme des luttes anticoloniales. Ces analyses sont indéniablement salutaires et extrêmement précieuses [L’on pourrait cependant émettre deux bémols. L’on peut tout d’abord regretter que soient parfois privilégiées des monographies sur Fanon que l’on peut juger un peu « datées », telles celles de Renate Zahar et Irène Gendzier (ce qui ne signifie aucunement qu’elles soient devenues inutiles) ce qui tend encore une fois à démontrer la trop faible pénétration des « Fanon studies » en France. L’on peut également mettre en question un certain « mélange » des questions de classe et des questions d’identité en rappelant que Fanon n’a guère de « problème d’identité » (qu’elle soit « psychologique », « culturelle », « ethnique ») au sens où on aime employer ce mot de nos jours et que « son » problème demeure avant tout un problème de conscience.]. L’on se demandera néanmoins et en demeurant dans la perspective qui est la nôtre, si ces analyses ne gagneraient pas encore à être intégrées dans une lecture du marxisme de Fanon en terme de « théorie voyageuse ». Car Fanon n’en appelle-t-il pas lui-même à une distension du marxisme [22] , à son extension géographique/géopolitique, à son élargissement au-delà des frontières de l’Europe, opération de déplacement aux conséquences « théoriques et politiques (…) fracassantes [23] » ainsi que l’affirme déjà Žižek au sujet de Mao. Il s’agirait, pour le dire autrement, de réintroduire Fanon dans une histoire horizontale-transnationale du marxisme contestant la verticalité d’une conception hiérarchique — dont il ne s’agit bien sûr pas de nier l’effectivité historique — au sommet de laquelle ne pouvait manquer de trôner le « marxisme européen » [Nous évitons volontairement ici la notion trop chargée de sens de « marxisme occidental » (introduite par Perry Anderson) et laissons par ailleurs de côté la question pourtant capitale de la position singulière de l’Union soviétique dans cette géographie (post)impériale du marxisme], jugé, quoi qu’on en dise ouvertement, toujours plus « authentique » que ses réappropriations et transformations en milieu extra-européen et colonial. C’est là sans aucun doute un très vaste programme soulevant de nombreuses questions. Reste que si une telle réinterprétation postcoloniale du marxisme devait être poursuivie de manière systématique [24] , Fanon y occuperait à coup sûr une place de premier plan aux côtés de nombreux autres intellectuels tels que, pour ne citer qu’eux, C.L.R. James, Tran Duc Thao, Jacques Roumain ou encore José Carlos Mariátegui.