Fatima Ouassak est une figure importante du militantisme des quartiers populaires. Elle a participé à la création d’Ensemble pour les Enfants de Bagnolet (EEB) ainsi qu’au Front de Mères en 2016, deux associations qui travaillent à améliorer la condition des enfants dans les quartiers populaires, et qui s’appuient pour cela sur un projet écologiste. Elle anime également le réseau Classe/ Genre/Race. Elle a publié en 2020 le livre La Puissance des mères, pour un nouveau sujet révolutionnaire aux éditions La Découverte, où elle fait état des nombreuses attaques subies au cours de son parcours militant, de la part d’agents institutionnels, d’élu·es ou de militant·es, y compris de gauche : marginalisation, récupération, assignations identitaires, disqualifications pour« communautarisme » … Nous avons souhaité échanger avec elle à ce propos[1], ses expériences et analyses faisant directement écho aux questionnements soulevés dans le livre Démobiliser les quartiers. Enquêtes sur les pratiques de gouvernement en milieu populaire, que nous avons coordonné et qui sort ces jours-ci[2].

Vous évoquez dans votre livre un certain nombre d’entraves et d’attaques de la part des pouvoirs publics, comment percevez-vous cette idée de « démobilisation » ? Y a-t-il des exemples que vous n’évoquez pas ?
C’est vrai qu’on a eu à affronter des attaques violentes. Je vous donne un exemple qui me semble révélateur. Nous avons organisé avec EEB en février 2018 à Bagnolet une conférence sur l’alternative végétarienne à la cantine. Nous avons invité des personnes de la ville de Fontenay-Sous-Bois où cela avait été mis en place et le maire de Fontenay a lui-même proposé de venir. Nous avons accueilli cette proposition avec enthousiasme car nous voulions montrer que l’alternative végétarienne répondait à des enjeux de santé publique, et non à des polémiques autour de la laïcité. Eh bien figurez-vous que les communistes locaux·les et la section locale de la Ligue des Droits de l’Homme ont envoyé un mail diffamatoire au maire et à son cabinet pour leur signaler, en privé bien sûr, que j’étais une « islamiste » et une « communautariste ». Le maire a tergiversé. L’argument qu’a avancé son cabinet, c’est qu’il savait ces accusations mensongères mais qu’il ne voulait pas finir dans Marianne. Ce qui est honteux ! Marianne, ce sont des ennemis politiques. Mais on ne va tout de même pas sacrifier son petit capital politique pour des Arabes. Dès qu’il s’agit de racisme et d’anti-racisme, il n’y a aucune prise de risque. La bonne nouvelle, c’est que nous avons été prévenues à propos du mail. Je ne me suis pas laissé faire, j’ai appelé les auteur·rices du mail en question pour leur dire à quel point c’était grave et que je comptais bien les dénoncer publiquement. Eh bien, dès lors que vous vous battez, ça marche : le maire était présent le vendredi, tout pimpant. Ça a été un tournant et le rapport de force nous est favorable désormais. Nous avons montré que nous aussi, nous avions des réseaux.
Donc c’est un peu le contraire de la « démobilisation » que l’on vit en ce moment. C’est important, en tant que chercheur·euses, que vous puissiez mettre en lumière les attaques que subissent les associations mobilisées, mais pour nous au Front de Mères ça ne reflète pas notre situation actuelle. Au contraire, j’ai même l’impression qu’ici à Bagnolet, on recueille aujourd’hui les fruits d’une stratégie de mobilisation ancienne des quartiers populaires et des luttes pour l’immigration. Nous nous situons avec EEB et le Front de Mères dans une lutte qui a déjà vingt ans. Et aujourd’hui, je dirais qu’on a presque inversé le rapport de force. Je l’évoque dans le livre. Je parle de victoire, qui s’inscrit dans une stratégie politique. C’est écrit comme un manifeste, pour dire : « venez il faut se battre ! »
Est-ce que vous avez subi le même type d’attaques de la part de la municipalité de Bagnolet ? Est-ce que l’émergence d’une liste citoyenne, Bagnolet en Commun, aux élections municipales de 2020, a changé la donne ?
La relation avec la gauche locale, c’est comme partout en France : instrumentalisation, confiscation de la parole, etc. Avec ici peut-être une spécialité pratiquée depuis des décennies : dès qu’il y a un début de mobilisation sur un sujet, le pouvoir local s’empresse de créer une association équivalente sur le même sujet. C’est ce qui s’est passé pour nous : on fonde une association de parents, une association similaire est créée dans la foulée avec appui politique et subventions ; on lance un projet d’écologie populaire, et tout le monde n’a plus que l’écologie populaire à la bouche. Soit. Je trouve que ce n’est pas problématique en soi : cela veut dire que nos questions avancent. Le problème, c’est que ce sont souvent des coquilles vides qui disparaissent dès le lendemain des élections. Ils ne font même pas semblant de continuer un peu. Ce n’est que pour faire de la concurrence au niveau électoral.
Je vous donne un autre exemple. En 2016, une personne qui dirigeait une association de parents para-institutionnelle nous contacte, nous dit qu’elle veut travailler avec notre association EEB, et propose de mettre son logo sur un tract que nous lui avions montré. Ravies, nous acceptons et prévoyons une campagne d’affichage autour d’une action commune. Le matin même de la campagne de communication, après avoir déposé les enfants à l’école et imprimé de notre poche des centaines de tracts et affiches, nous recevons un mail de cette directrice d’association, avec copie à plusieurs élu·es de la Ville issu·es d’une ancienne liste citoyenne, où elle dit découvrir le tract avec son logo dessus et, scandalisée, se plaint de ne pas avoir été mise au courant. Panique à bord et campagne avortée. Le mail de la directrice a ensuite été utilisé par un élu, qui l’a fait circuler partout à Bagnolet pour dire à quel point nous avions instrumentalisé la parole de cette femme, nous étions des menteuses, etc. C’était bien sûr l’objectif. Ça a été très dur. Cette histoire de logo, je ne connaissais pas, j’ai découvert à cette occasion que c’est une petite combine qui se pratiquait beaucoup. Ça a été un coup porté. Notamment pour celles qui parmi nous n’avaient jamais milité et étaient tentées de tout arrêter, dégoûtées par de telles pratiques. Pour ce qui est des listes citoyennes, le problème c’est que lorsqu’elles arrivent en mairie, elles veulent être les seules légitimes à parler au nom des quartiers populaires. Du coup, ces élu·es peuvent adopter les mêmes travers répressifs si on ne va pas dans leur sens.
Aujourd’hui, avec les élu·es de la liste citoyenne Bagnolet en commun, nous tentons une expérience d’appui mutuel avec un pied dans le quartier et un pied en mairie. Pour l’instant ça fonctionne bien, nous travaillons sur plusieurs projets communs. Même s’il faut être vigilantes à ne pas voir ces élu·es être utilisé·es comme tampons pour nous rendre moins combatives. Pour ce qui concerne l’alternative végétarienne par exemple, qui pourtant avait été acceptée sur le principe, nous avons dû repartir au front nous-mêmes car les procédures s’éternisaient. Nous avons commencé à mobiliser contre le lobby de la viande et les anti-écologistes. Eh bien, l’alternative végétarienne a été mise en place en deux minutes. C’est grâce à la pression extérieure, nationale, des réseaux, notamment écologistes, sur le local. Ça, c’est vrai que ça marche. Il faut le tester, l’expérimenter.
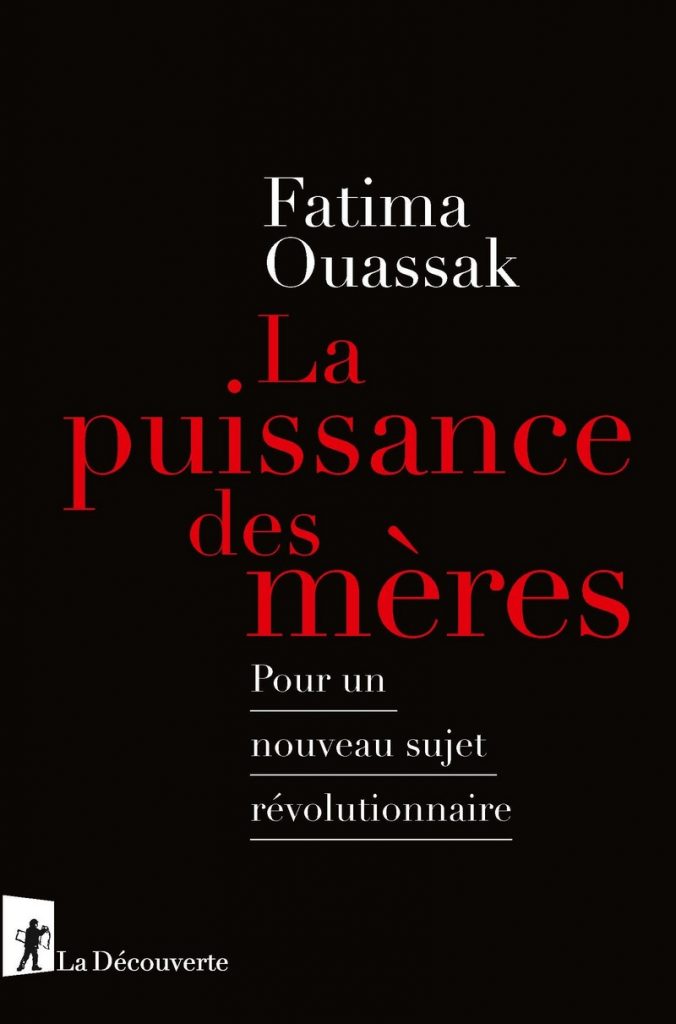
Comment vous positionnez-vous face aux autres organisations de gauche ? En particulier concernant la question raciale, qui reste très peu portée.
Nous, c’est l’autonomie. On parle d’organisation à organisation. On a toujours refusé de jouer le rôle de poil à gratter antiraciste pour la gauche radicale. Parce qu’on ne veut pas être réduites à la question raciale. Il est hors de question d’avoir une division du travail militant où certain·es auraient des propos généraux, globaux et où nous on se contenterait de parler de la seule question raciale, comme pour décorer la scène. J’explique dans mon livre que c’est une division raciste du travail militant. Certain·es ont l’universel et le pouvoir politique qui va avec, et d’autres sont renvoyé·es à des adjectifs qualificatifs. J’ai toujours insisté pour qu’il n’y ait pas d’adjectifs après « écologie ». Par exemple, on m’invite beaucoup pour parler d’écologie et on essaie de m’imposer « écologie décoloniale » ou « écologie populaire »… Parfois ça me sert, parfois non. Il n’y a pas de raison qu’on me colle systématiquement ce type d’adjectifs qualificatifs alors qu’on n’accole jamais rien à l’écologie qui est, de fait, pavillonnaire ou blanche. Ça paraît toujours naturel que quelqu’un comme moi soit mobilisée sur la question de l’islamophobie par exemple, mais j’ai aussi la prétention de mobiliser sur une ligne écologiste, féministe ou anticapitaliste.
Vous insistez beaucoup sur la disqualification que vous avez subie au Front de Mères ainsi que les tentatives de récupération, est-ce que vous pouvez nous parler de la question des moyens matériels et de la manière dont votre association parvient à perdurer ?
C’est une question centrale pour moi. Beaucoup d’organisations de gauche n’ont qu’à claquer des doigts pour avoir des dons. C’est vrai que nous, les organisations des quartiers populaires, on a moins accès à ces financements privés. Un peu du côté musulman, mais ce ne sont pas nos réseaux. Sur la dimension écologiste et antiraciste, il n’y a pas encore beaucoup de financements. À terme, il faudrait avoir nos lieux et nos sources de financements pour nous permettre de tenir. C’est ça le but. Et d’ailleurs, le lieu, beaucoup plus que l’argent. Nous, pour l’instant, on fait sans argent. On n’est pas payées, on est des militantes à l’ancienne. Et s’il doit y avoir de l’argent, on n’a pas besoin d’avoir des salariées. Ça ne va pas nous enserrer dans un système clientéliste où on peut nous mettre la pression et nous supprimer des salaires. Au niveau des locaux, on a obtenu, avec le soutien de la Ville de Bagnolet il faut le souligner, un lieu assez énorme que l’on partage avec Alternatiba avec qui on travaille étroitement depuis deux ans. On l’a appelé Verdragon, maison de l’écologie populaire. C’est très positif, on va enfin pouvoir travailler à une écologie du point de vue des habitant·es des quartiers populaires et ancrée dans ces territoires, et s’organiser dans de bonnes conditions. Cela ne nous empêche pas de réfléchir sur le long terme à occuper un peu partout en France des lieux dédiés au Front de mères seul.
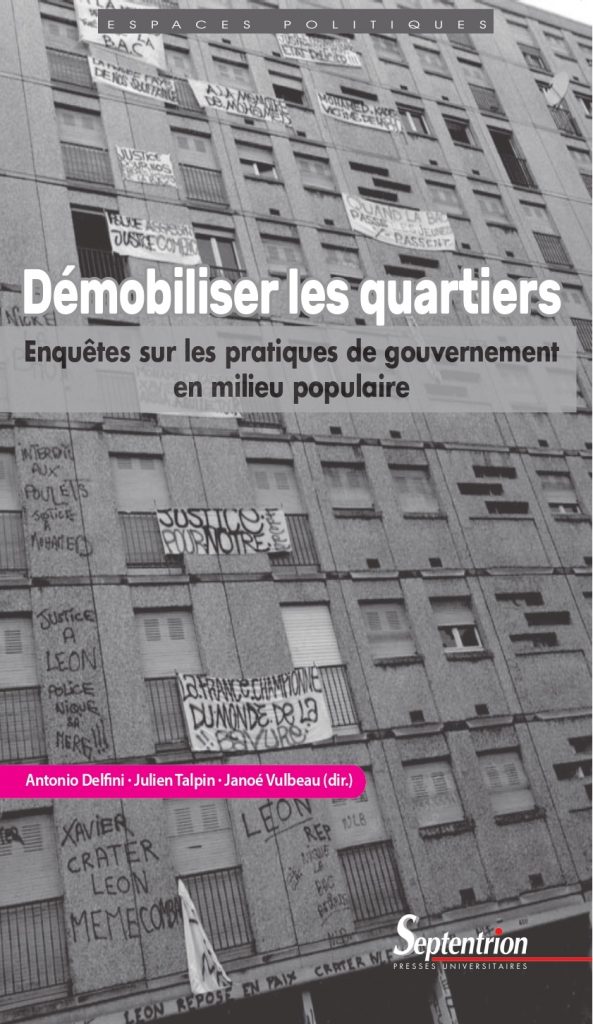
Est-ce que vous avez l’impression qu’il y a une répression qui s’applique différemment en fonction du genre ?
Sur ce point, il y a plusieurs choses. Les mobilisations des mères des quartiers ont plutôt une bonne image. Lorsque je travaillais il y a quelques années à la Politique de la Ville, j’ai compris à quel point les pouvoirs publics soutiennent les initiatives de mères. Il y a un a priori que ce sont des personnes qui vont tempérer, calmer la situation, permettre de lutter contre la délinquance, la drogue, etc., bref contre les jeunes du quartier. Mais dès lors qu’on se rend compte que ce n’est pas leur projet, et qu’au contraire elles cherchent avant tout à mobiliser politiquement… elles sont traitées comme des hommes. À ce moment-là, c’est vraiment la guerre. On a tendance à dire que ce sont surtout les jeunes hommes qui posent problème, que les femmes passent mieux. Mais le sexe ce n’est pas forcément déterminant pour comprendre la disqualification. L’élément déterminant, c’est si vous faites de la politique ou pas. Si vous avez un projet de remise en question du système pour plus de justice, plus d’égalité réelle… À ce moment-là, que vous soyez un homme ou une femme, c’est pareil : vous êtes un adversaire. Si je prends mon cas, pour me disqualifier, ce qu’on a beaucoup utilisé c’est la figure de l’islamiste, c’est la mosquée, le foulard. Pendant plus d’un an, des personnes à Bagnolet qui se prétendaient écologistes ont fait circuler la rumeur que par le passé j’étais voilée. L’expression qui était utilisée, c’est que je ne portais plus le voile sur la tête mais dans la tête. C’est intéressant parce que des femmes musulmanes qui portent un foulard ont malgré cela été sollicitées pour être sur une liste électorale. Ce qui montre bien que ce n’est pas le voile en lui-même qui pose problème mais bien le projet politique et notamment les aspirations à plus d’égalité. Après, il faut être bien conscient·es que pour de jeunes hommes musulmans, noirs ou arabes, c’est quasi impossible de se mobiliser. Il n’y a pas aujourd’hui en France d’organisation massive de jeunes de quartier par exemple. Il y a un début de quelque chose à Ivry, avec le collectif Romain Rolland[3], mais sinon c’est dur.
Est-ce que vous voyez d’autres types de contraintes rendant plus difficile l’engagement militant ?
Je pense qu’il peut y avoir une pression familiale. Des femmes du collectif de Bagnolet ont dû arrêter de militer parce que leurs proches trouvaient que c’était du temps perdu. C’est une injonction qu’on a particulièrement en tant que mère : il faut s’occuper de ses propres enfants.
Par exemple, on s’est mobilisées dans une cité pas très loin. Pour beaucoup de femmes, qui n’habitent pas le quartier, c’était compliqué de justifier à leur entourage qu’elles allaient militer ici alors qu’elles n’étaient pas directement concernées. D’autant plus que dans le quartier en question la mobilisation était difficile parce que les gens avaient peur du bailleur. Les gens ont tellement peur de perdre qu’ils vous laissent aller au front. Si vous gagnez tant mieux, si vous ne gagnez pas, ils n’auront pas perdu leur demande de logement pour descendre de dix étages. Du coup, pour beaucoup d’entre nous, c’était difficile de justifier de l’importance de la mobilisation au sein de nos familles.
Je crois aussi que c’est révélateur du rapport à la politique dans les quartiers. Souvent, « politique » c’est vu comme quelque chose de négatif. Parce qu’on se dit que si vous militez c’est que vous voulez en tirer des bénéfices, de l’argent, que vous voulez faire une carrière sur le dos des gens. Typiquement, la liste citoyenne qui avait été élue sur le précédent mandat était composée de personnes qui militaient auparavant. Une fois élu·es, du jour au lendemain, iels se sont retourné·es contre les quartiers. Et quand vous passez derrière pour dire : « nous on est sincère », ça peut être compliqué.

Est-ce que ça provoque des formes d’épuisement militant ?
Oui. Je sais que j’ai pu faire des fois des « dépressions politiques ». Surtout quand vous êtes isolée. Je raconte dans le livre une des scènes avec la FCPE. Je venais juste d’accoucher de mon fils. J’étais plus sensible à ce moment précis de ma vie, et pas assez organisée politiquement. Il y avait douze personnes contre moi et quelqu’un se lève et me dit que je suis violente. Quand il y a douze personnes qui vous disent que vous êtes un problème, c’est difficile de se dire que ce n’est pas vrai. Il y avait aussi des gens dans mon entourage qui me disaient que je me fatiguais pour rien, que ça ne servait à rien de me battre.
Plus largement, il se trouve que dans le milieu militant de l’immigration et des quartiers populaires, il y a énormément de pillages et de récupérations. C’est un sport national. Il y a beaucoup de militant·es qui ont pu souffrir de ça. Tu t’es épuisé·e sur des tâches qui sont souvent les plus pénibles du militantisme, et tu vois des gens qui débarquent qui sont des intellectuel·les, des universitaires, des gens qui ont plus de capital culturel, iels reprennent ce que tu as fait, et iels capitalisent dessus. Ça a été le cas pour des personnes du Mouvement Immigration Banlieue (MIB). Je connais une personne à Bagnolet qui a milité ici durant toutes les années 1990 et il n’en reste rien : que de la rancœur. Et franchement une rancœur légitime étant données ses conditions matérielles d’existence aujourd’hui et l’impossibilité de voir son travail militant reconnu. L’histoire des luttes de l’immigration et de la classe ouvrière est une histoire de récupérations et de confiscations. Je connais bien cette histoire, ce qui explique pourquoi c’est si important pour moi de laisser une trace des luttes auxquelles j’ai participé et de la réflexion qui a mené à ces luttes.
S’il est crucial de visualiser les formes de répression et de difficultés du militantisme, vous montrez aussi tout ce que permet l’engagement politique.
Oui. Pour moi une vie sans lutte, c’est une vie qui ne sert à rien. Encore plus quand on a des enfants. Je trouve que c’est encore plus irresponsable de ne pas militer, de ne pas lutter. Concernant l’alternative végétarienne à nouveau : on a reçu récemment un papier officiel de la mairie dans le carnet scolaire pour savoir si on voulait l’alternative végétarienne à la cantine. Pour ma fille qui a huit ans, cette histoire d’alternative végétarienne est gravée dans sa tête. Elle a tendu le papier à signer avec tellement de fierté. Quand on a commencé cette mobilisation, elle avait trois ans. Elle a bien vu que sa mère et les mères du quartier s’étaient mobilisées. On ne se rend pas compte de ce que c’est pour un enfant de voir que la lutte est gagnée. C’est important pour moi. J’élève mes enfants dans la dignité. La fierté de mes enfants, c’est ma fierté. Il faut pouvoir conscientiser ça et le valoriser. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’argent qu’il n’y a pas de gloire. On ne valorise pas assez cette fierté alors que je suis sûre qu’il y a plein de gens qui adoreraient pouvoir éduquer leurs enfants dans la lutte et la victoire.
Mais tout ça existe quand même, je connais plein de gens qui militent et qui sont bien. Militer, ce n’est pas que s’épuiser. C’est des espaces où on s’amuse, on rencontre des ami·es, on est solidaires. C’est aussi une super garde d’enfants. Quand on est une mère mobilisée, on s’arrange pour que nos enfants militent avec nous.
[1] Entretien réalisé par Janoé Vulbeau, doctorant en histoire et science politique, IEP de Rennes.
[2] A. Delfini, J. Talpin, J. Vulbeau (dir.) Démobiliser les quartiers. Enquêtes sur les pratiques de gouvernement en milieu populaire, Presses Universitaires du Septentrion.https://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100333020
[3] Le collectif Romain Rolland a été créé en 2019 à la suite des gardes à vues et des poursuites judiciaires de plusieurs élèves après l’inscription du message « Macron démission » sur un tableau du lycée.


