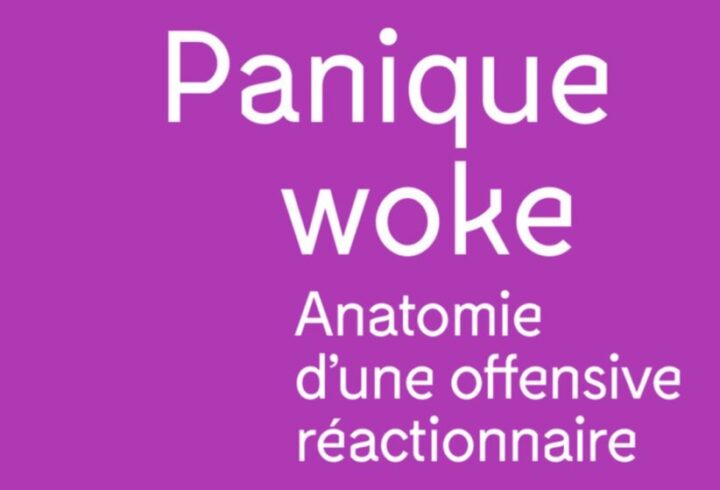La rentrée littéraire 2022 compte, parmi ses publications, un ouvrage dont la présentation commence par ces termes : « Une vague de folie et d’intolérance submerge le monde occidental ». S’agit-il de dénoncer la montée des néofascismes en Europe et aux États-Unis ? De critiquer le durcissement autoritaire dont s’accommode au mieux le néolibéralisme ? De déplorer la violence des « backlash », ou retours de bâtons, subis par les mouvements progressistes dont les voix s’élèvent depuis plusieurs années ? Il n’en est rien. L’ouvrage en question, écrit par Jean-François Braunstein et intitulé La Religion Woke vient nous alerter contre un mal qui semble plus dangereux encore : « Venue des universités américaines, […] la religion des “éveillés”, emporte tout sur son passage : universités, écoles et lycées, entreprises, médias et culture. » Mais qu’est-ce que le « wokisme » ? Et surtout, qu’est-ce la panique morale contre le « wokisme » dit du débat politique actuel et en particulier de ses tendances conservatrices ?
Alex Mahoudeau dispose d’un doctorat en science politique et a participé aux travaux du Lab’urba. En parallèle de travaux sur la dimension spatiale des mouvements sociaux, Alex a analysé les discours de publications sur le « wokisme » en tant que mobilisation conservatrice.
Introduction
Dérivatif de la locution AAVE[1] « woke » signifiant « éveillé·e »[2], le néologisme « wokisme »[3] émerge en 2021. On en trouve une « définition assez précise » fournie par Face au Wokisme, un rapport de la Fondation pour l’Innovation Politique (Fondapol), think tank conservateur fondé en 2004 pour servir de laboratoire d’idées à la droite de gouvernement (Valentin, 2021a, 2021b)[4]. Cette définition est elle-même une citation du sociologue canadien Mathieu Bock-Côté :
Dans un contexte de combat en matière de justice sociale, cette expression définit quelqu’un qui est sensibilisé aux injustices qui peuvent avoir lieu autour de lui. On utilise souvent cette expression en opposition à « être endormi », soit ne pas être éduqué sur les enjeux socio-économiques et sur les questions raciales (Bock-Côté, 2021, p. 72 in. Valentin, 2021a).
L’année suivante, le néologisme est intégré à plusieurs dictionnaires de la langue française, sur un mode auto-référentiel et soulignant le caractère souvent péjoratif du terme (« idéologie d’inspiration woke, centrée sur les questions d’égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l’universalisme républicain », dans le petit Larousse, et « Courant de pensée d’origine américaine qui dénonce les injustices et discriminations », dans le petit Robert). Le terme avait néanmoins précédemment été inclus dans certaines versions en ligne de ces mêmes dictionnaires, passant ainsi, en quelques semaines, de néologisme inusité à terme bénéficiant d’une reconnaissance institutionnelle dans la langue et le débat public français.
La seconde moitié de l’année 2021 voit ainsi l’émergence rapide d’un intérêt médiatique autour de l’enjeu du développement du « wokisme » et des effets supposés de ce phénomène dans divers mondes sociaux, principalement l’université, les médias, le monde de la culture, et une « culture d’entreprise » définie de façon floue. Des entrepreneur·euses politiques mobilisant le terme font état d’un usage antécédent à l’année 2021 dans le débat francophone : un article paru dans le journal Le Monde en 2018 titre ainsi « Ne soyez plus cool, soyez “woke” » (2018) tout en demeurant un exposé des inquiétudes de deux intellectuels critiques du phénomène, l’éditorialiste David Brooks et le critique littéraire Thomas Chatterton Williams. Si le premier est un auteur conservateur reconnu et respecté, il faut également remarquer que le second, tout en ne se revendiquant pas de cette orientation, a pris part au débat de façon nette avec les mêmes orientations.
Le terme s’éloigne, dans le contexte français, des sens qu’il recouvrait aux États-Unis, et ce, de plusieurs façons. D’abord par un procédé de réification : l’adjectif woke au sens originellement polysémique, désignant à la fois une attitude, un slogan, et un ensemble flou de valeurs et d’idées devient une idéologie via un substantif, wokisme, au contenu supposé cohérent et décrit comme un « mouvement ». Par ailleurs, ainsi que l’a remarqué Aja Romano, le slogan est passé en quelques années d’une expression relativement peu connue liée aux mouvements antiracistes états-uniens, à une référence fortement identifiée à ceux-ci, avant d’être vidée de sa substance et changée en charge péjorative essentiellement employée par les milieux conservateurs. En France, c’est bien cette itération du terme, et pas ses usages précédents, qui a été intéressée sous la terminologie de wokisme.
Les usages du terme connaissent une croissance considérable à partir de l’année 2021, et plus spécifiquement à la suite de la parution de deux notes sur « l’idéologie woke » par la Fondation. Cette étude serait plus adéquatement décrite comme une revue de la littérature critique de ce supposé phénomène, allant piocher à la fois dans la littérature grise et militante, dans des essais de pop-psychologie, et dans des lectures partielles d’un ensemble hétéroclite d’œuvres relevant d’un vaste champ d’études portant notamment sur les rapports sociaux de race, classe et genre. Cette publication, associée à quelques autres[5], a un effet de « mise à l’agenda » de la thématique du « wokisme ». Elle conduit à l’émergence pas tant d’une controverse, que d’une affaire : en effet, la grande majorité des publications et interventions qui se développent à partir de l’été 2020 ne sont pas dans le registre de la confrontation entre deux « camps », mais dans celui de la dénonciation d’un « camp » par un autre. Cette dénonciation se nourrit très rapidement d’un flux d’anecdotes prenant place sur des campus, dans des médias, ou dans des entreprises, et censées illustrer les méfaits du « wokisme ». Outre une quantité importante d’articles d’opinion, d’analyses et d’« enquêtes » consistant généralement à demander à une partie des protagonistes d’une de ces affaires son avis sur le sujet, il faut noter la popularité éditoriale du terme dans le cadre d’une série d’essais marquant la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021. Ceux-ci dénoncent pêle-mêle « racialisme », « théorie du genre », « décolonialisme », termes généralement employés en parallèle de celui de « wokisme », tout en ayant émergé dans le débat public avant celui-ci.[6]
Cet article se concentre sur l’émergence et les usages du thème du « wokisme », pas tant dans son contenu qu’en tant que cadrage, pour reprendre le concept inspiré de la sociologie goffmanienne (Goffman, 1974).
Identifier la panique woke
Le concept de panique morale, issu de la sociologie des médias, et notamment des travaux de Stanley Cohen (2011) et de l’équipe travaillant autour de Stuart Hall (2013), vise à simultanément rendre sens et relativiser les épisodes de surmédiatisation et de dénonciation de certains phénomènes et groupes sociaux, en allant à l’encontre d’une représentation de ceux-ci comme relevant d’un phénomène d’irrationalité collective, et en les resituant au croisement de rapports de pouvoir. Synthétiquement, le fait que la presse britannique développe un intérêt disproportionné pour les bagarres entre bandes durant les années 1960 en dit moins de la réalité de la violence entre gangs que de la presse elle-même, une perspective ancrée dans une tradition de sociologie de la déviance bien établie.
Les sociologues Erich Goode et Nachman Ben Yehuda (2009) identifient plusieurs courants théoriques concernant les paniques morales, une ligne de rupture consistant à savoir si elles trouvent l’origine dans une « fabrique du consentement »[7] par en haut, ou dans une émergence par en bas. La réponse à ce dilemme étant, comme souvent en sciences sociales, « un peu des deux », l’opinion n’étant ni tout à fait autonome, ni tout à fait dépendante des interventions d’acteurs politiques ou médiatiques. Goode et Ben Yehuda identifient toutefois cinq éléments consensuels définissant les paniques morales :
1. Elles présentent un caractère d’inquiétude (concern) vis-à-vis du comportement d’un groupe,
2. Ce groupe fait l’objet d’un discours d’hostilité qui inclut généralement une attribution de responsabilité, ainsi qu’une réification du groupe via la construction d’un stéréotype,
3. La réalité du phénomène causant l’inquiétude doit faire l’objet d’un consensus au sein d’une portion suffisamment significative de la population pour ne pas pouvoir être ignorée par les autres,
4. La réaction doit être disproportionnée aux faits décrits, soit par le caractère exagéré de ces descriptions, soit parce qu’elles sont des inventions pures et simples, et enfin,
5. La panique morale est volatile, conduisant soit à une institutionnalisation de cette dernière (qui devient alors un problème public), soit à une disparition sans autres traces que les mesures prises à la hâte pour y faire face au moment de son explosion.
L’ensemble de ces éléments oscille entre jugement subjectif et objectif. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne le critère le plus important identifié par les auteurs, la disproportion : après tout, toute position politique peut être perçue comme disproportionnée du point de vue de celles et ceux qui s’y opposent. Le « wokisme » correspond de façon consensuelle aux trois premiers critères énoncés par les sociologues. La séquence médiatique qui s’ouvre à l’été 2020 consiste bien, pour les entrepreneurs de problème public cherchant à mettre le sujet à l’agenda, à évoquer une inquiétude concernant les effets du phénomène. Celui-ci est décrit comme une menace potentielle sur l’ordre social. Il s’agit d’ énoncer une responsabilité sous la forme d’une diabolisation des « wokistes » ou des « wokes », laquelle s’appuie sur la construction d’un stéréotype psychiatrique (même s’il ne faut pas négliger la prégnance d’un traitement sur le thème de la conspiration, les articles décrivant le « verrouillage » et « l’entrisme » dans telle ou telle institution faisant florès). Les « wokes » sont ainsi pour la Fondapol « les helicopter parents, ces parents qui surveillent en permanence leurs enfants, génèrent des helicopter bureaucracies, et la surprotection de l’enfant devient la surprotection de l’étudiant dans le monde universitaire. Cette surprotection a ainsi généré une fragilité, et cette fragilité entraîne une demande de surprotection » (2021). Le sujet fait suffisamment consensus pour justifier non seulement une présence médiatique considérable, mais aussi une intervention sous forme de politiques publiques, notamment par le biais du ministre de l’Éducation nationale et de la ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, mais également par celui de plusieurs député·es, de groupes d’intérêt, d’intellectuel·les public·ques, etc. Par ailleurs le signifiant woke devient très rapidement un substitut recouvrant le contenu de paniques morales précédentes, notamment celle de la « théorie du genre », et servant partiellement à leur réactivation.[8] Si le critère de volatilité est par définition impossible à établir tant que dure la panique morale, il nous est possible de constater que le terme est passé en quelques mois de position de signifiant relativement obscur, circonscrit à quelques tribunes, à instrument d’action publique mobilisant au moins un ministère. Reste donc à qualifier la disproportion.
Celle-ci peut être repérée de plusieurs façons, à commencer par le nombre réduit d’événements associés à cette montée du « wokisme ». Dans le « rapport » (Salvador, 2021) produit par l’Observatoire du Décolonialisme, un collectif informel de chercheurs et chercheuses, dont un certain nombre de signataires de « l’Appel des Cent » d’octobre 2020, il est possible de relever 16 cas relevant de la « cancel culture » à l’université en France entre 2019 et 2021, incluant des appels au respect d’un piquet de grève, une campagne d’injures ayant ciblé une enseignante en 2016, l’existence d’un guide sur les usages de l’écriture inclusive dans une revue scientifique, une plainte portée par la LDH après qu’une enseignante a tenu des propos jugés islamophobes en cours, et le communiqué du CNRS refusant de préparer un rapport sur le prétendu « islamo-gauchisme ». Les cas restants concernent diverses menaces de chahutage de conférences – dont un par un collectif nationaliste s’opposant à des travaux sur la Shoah en Pologne, un exemple douteux pour illustrer ce qui serait de l’antiracisme poussé à l’extrême – et les cas emblématiques cités le plus régulièrement par la presse sur le sujet : l’annulation de la conférence de Sylviane Agacinski, « L’être humain à l’époque de sa reproductibilité technique », à l’Université de Bordeaux Montaigne en 2019 ; celle d’un séminaire tenu par Mohamed Sifaoui dans le cadre de la formation professionnelle à la Sorbonne la même année ; la contestation de la représentation de la pièce Les Suppliantes dans la même université quelques mois plus tôt ; et « l’affaire » de l’IEP de Grenoble en 2021. Même en considérant les cas cités, le « fléau » décrit semble à relativiser au moins sur le plan quantitatif. Cela semble également être le cas du « verrouillage » supposé des enjeux de race en sciences sociales, dans un pays qui ne compte pas de département consacré à la question et avec une portion congrue du sujet dans les travaux publiés aussi bien que des profils de postes. Ce dernier point permet de faire émerger un autre élément caractéristique de la disproportion, à savoir l’invention de chiffres exagérés, le même « observatoire » publiant en avril 2021 un chiffre ambitieux : le « décolonialisme » concernerait plus de la moitié des publications en sciences sociales. Ce résultat est obtenu selon une méthodologie incluant tout usage du terme genre dans la base de donnée « Open Editions » comme une recherche portant sur le concept de genre[9]. Cette statistique farfelue a pourtant été reprise de façon parfaitement sérieuse non seulement par la presse, mais également par certain·es chercheur·euses dans des essais reprochant pourtant aux sciences sociales de s’oublier par militantisme (Heinich, 2021).
Cette disproportion se retrouve hors de la sphère académique, certains médias se faisant durant l’année 2021 les diffuseurs de faits divers sans importance censés illustrer les dangers du « wokisme », comme par exemple le fait qu’une marque de jouets ait décidé de renommer l’un de ses produits (Vilanova, 2021), qu’un éditeur privé ait décidé de ne pas republier des œuvres au contenu raciste (Couturier, 2021b), ou l’intégration d’un pronom neutre dans la version numérique d’un dictionnaire (Bulant, 2021). La disproportion ne prend son sens qu’en comparaison avec d’autres problèmes sociaux : toutes choses égales par ailleurs, une affaire de changement de communication d’une entreprise ne pouvant pas être cadrée comme « wokisme » ne bénéficie pas d’une telleattention médiatique. De la même façon, ce n’est qu’à condition que le « wokisme » puisse en être vu comme l’origine que la capacité d’entreprises à imposer une vision du monde à leurs employés que cela pose problème à un organisme comme le MEDEF, qui organise durant son université d’été 2021 une conférence-débat sur le thème de « la culture woke ».
En comprenant le « wokisme » comme une panique morale, il devient possible de cesser de se demander ce que le terme recouvre (tout et n’importe quoi) et de se demander ce qu’il fait. En cela, sa popularité durant et dans la foulée d’une série de mobilisations d’ampleur, notamment sur la question du racisme, peut être comprise comme une entreprise de recadrage de ces mobilisations : ainsi que je l’ai décrit plus haut, les deux théories du monde social sous-jacentes aux dénonciations du « wokisme » ont pour effet d’en dépolitiser les usages, pour en faire l’expression d’un problème psychologique ou la conséquence d’un complot malveillant. Le diagnostic implicite exclut dès lors de faire face aux revendications – de toute façon considérées comme factices – de ces mobilisations, pour se demander quelle forme de répression, et le cas échéant de prise en charge médicale, peut juguler le développement du « virus idéologique » :
Les droites sont à la conquête du sens commun, elles donnent à chacun le loisir de recomposer en permanence sa vision du monde en pensant menacée sa situation personnelle, la vie de son quartier, l’école de ses enfants, etc., par un ennemi imaginaire. Les paniques morales produisent alors leurs effets concrets : le vote d’extrême droite s’accroît, les droites parlementaires se radicalisent, et les gauches renoncent (Brustier, 2013).
Le « wokisme » comme cadrage
Percevoir le « wokisme » comme une panique morale ne signifie pas (uniquement) s’inscrire en faux face à la réification du terme et adopter une posture critique face aux discours qui l’opèrent, mais également se permettre d’émettre des hypothèses sur ce que « fait » le terme. Dans cette partie, je propose de l’appréhender comme une entreprise de renversement des représentations de diverses mobilisations, dont l’émergence et l’imposition se comprend comme un « coup » joué par des acteurs disparates. En ce sens, la panique morale autour du « wokisme » est l’occasion d’un recadrage de situations liées aux inégalités et à la liberté d’expression. Je m’appuie ici sur l’approche du terme « cadrage », repris du vocabulaire goffmanien pour analyser les dynamiques par lesquelles des représentations collectives de la réalité sociale émergent dans les dynamiques d’action collective (Snow et Benford, 2000).
Des travaux précédents ont montré le rôle de processus consistant à re-cadrer des situations liées à des mobilisations, notamment anti-racistes, dans l’émergence et le développement de la « nouvelle droite » états-unienne, ou « alt-right », durant les années 2010. Dans plusieurs publications, Simon Ridley revient ainsi sur le rôle d’épisodes marquants permettant aux activistes de ce groupe d’imposer leurs représentations dans un certain nombre de conflits, par exemple sur le campus de l’Université de Berkeley, autour de la proposition de retirer la statue d’un général confédéré :
Les défilés de ces deux journées attirent l’attention internationale du fait de la violence dont ils sont le théâtre. Si la mort de la contre-manifestante antiraciste Heather Heyer a choqué le monde entier, l’alt-right ne modifie pas pour autant sa tactique. À la rentrée 2017, elle organise une « Free Speech Week » et invite à cette occasion des personnalités de la droite extrême sur le campus. L’événement est annulé à la dernière minute et une manifestation est organisée pour crier à la censure. Cette fois-ci, les organisations se dirigent vers le People’s Park où, dans son discours, Based Stickman parle d’une « guerre contre les Blancs » (Ridley, 2020).
En se faisant ouvertement les gardiens de la liberté d’expression et du patrimoine sur le campus de Berkeley, les militants d’alt-right parviennent paradoxalement, pour Ridley, à imposer un contre-coup au mouvement antiraciste dont l’effet se ressent d’une manière plus générale par un tour de vis qui touche étudiant·es et enseignant·es opposé·es à leurs idées. Le slogan « liberté d’expression » prend ici un sens excluant, le maintien de celle-ci impliquant également la mise sous silence de certain.es. C’est une telle lecture située dans le temps d’un terme qui permet de comprendre les usages militants de la catégorie « wokisme ».
La publication de la « Lettre sur la justice et un débat ouvert », publiée le 7 juillet 2020 dans Harper’s Magazine, et deux jours plus tard dans Le Monde, ouvre une séquence similaire durant un mouvement antiraciste d’ampleur suite au meurtre de George Floyd aux États-Unis. Un recadrage du débat en termes de liberté d’expression a ainsi lieu, cette fois-ci porté par des acteur·ices médiatiques davantage que des militant·es « de terrain ». Inquièt·es du développement d’une « cancel culture »[10] qui mettrait en péril les conditions du débat démocratique, les signataires alertent ainsi sur la façon dont les mobilisations en cours pourraient conduire à des atteintes à la liberté d’expression. Cette approche fait rapidement l’objet de reprises de la part de personnalités publiques (ministres, député·es, personnalités politiques, et chef de l’État) et dans diverses arènes médiatiques, notamment autour de l’enjeu du patrimoine et des statues[11], mais également de controverses ayant eu lieu dans diverses institutions universitaires. La fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021 voient ainsi un réalignement d’une partie du débat public, depuis les enjeux mis en avant par les mobilisations de rue antiracistes, vers la question du « racialisme » et de la « cancel culture » sur « les campus universitaires », notamment. C’est dans un tel contexte de production narrative et discursive que les mobilisations antiracistes sont construites comme problème public. Cela s’accompagne d’une requalification de la responsabilité, qui vient opposer à des analyses structurelles du racisme plusieurs diagnostics alternatifs, notamment en termes de santé mentale (Haidt et Lukianoff, 2018) et d’excès d’un activisme au sein des « campus universitaires » (Lindsay et Pluckrose, 2021). Le blâme est ainsi redirigé vers les activistes elles et eux-mêmes.
Construite autour de la question du racisme, cette présentation de la situation causée, non pas par une situation d’inégalités, mais par l’explosion perçue de théories « victimaires » dans des départements de sciences sociales, entre en résonance avec d’autres discours similaires s’étant développés les années précédentes, autour de la question du terrorisme, du féminisme, et des luttes en faveur des minorités sexuelles et de genre. Le signifiant wokisme, conçu à l’été 2021, permet de placer l’ensemble de ces sujets dans une catégorie unique. En cela, il ne faut pas courir le risque de séparer artificiellement le « wokisme » du continuum de paniques morales dans lesquelles il s’insère : reformulation partielle de « la théorie du genre » (Kuhar et Paternotte, 2020), du « communautarisme » (Mohammed et Talpin, 2018), ou de « l’islamo-gauchisme » (Gautier et Zancarini-Fournel, 2022), le terme a pour effet principal la construction d’une image négative dont les contours démarquent tout ce qui ne correspond pas, au moment de sa dénonciation, à une certaine idée d’une société aux hiérarchies légitimes face au chaos – supposé – qui viendrait avec toute opposition.
************
Dans cet article j’ai défendu l’idée que le « wokisme » doit être perçucomme une forme particulière de cadrage ou de labellisation, sous-tendant une certaine représentation du politique. Contrairement à ce qu’en disent les entrepreneurs de cause du problème woke, celui-ci ne correspond pas tant à une réalité émergente qu’à une résurgence d’inquiétudes anciennes du mouvement conservateur. Le fait que les discours et le traitement du phénomène correspondent au modèle de la panique morale ne doit pas tantêtre pris comme une contestation, que comme une façon d’objectiver le phénomène pour l’analyser politiquement et sociologiquement. Quand une vision classique des paniques morales y voit une façon « populaire » d’appréhender le politique, la panique woke semble – du moins, pour le moment – être essentiellement un phénomène touchant les « élites », intéressant davantage ministres et éditorialistes que le mythique « homme de la rue » : « La prédisposition à la crédulité et au fantasme n’est pas le propre d’une couche sociale mais l’attestation d’une faculté proprement humaine à l’imagination – au risque parfois de s’y laisser piéger », comme le remarque Lilian Mathieu (2015).
Il demeure qu’il n’est pas possible d’évoquer le phénomène sans constater ce à quoi il constitue un « backlash », à savoir une série de « coups » contre des mobilisations portant sur des thèmes émancipateurs, sur le plan du racisme, du sexisme, mais aussi de la question de la classe. En effet les discours dénonciateurs anti-« wokisme » ne manquent pas de multiplier les comparaisons au communisme, reprenant à leur compte les antiennes maccarthystes qui forment leur généalogie. En cela, la panique woke peut être appréhendée comme une façon de reconstruire de l’hégémonie en creux, dans un contexte où les promesses du mouvement conservateur semblent se restreindre au maintien de hiérarchies sociales rigides, et à un programme inégalitaire et austère. Il ne semble d’ailleurs pas anodin qu’un an après l’ « explosion » des usages du terme, quasiment les mêmes réseaux intellectuels soient au travail pour réactiver – via un cadrage similaire, autour de l’enjeu du « débat » et de la liberté d’expression – une panique anti-genre autour de la question du « transactivisme », laissant suspecter que c’est en effet moins le fait « wokisme » qui se révèle intéressant dans cette séquence, que la façon dont elle laisse entrevoir une certaine grammaire de l’action politique.
[1] African American Vernacular English
[2] Le choix de l’écriture inclusive est ici motivé par un impératif double : celui de répondre aux normes en cours dans la revue Mouvements, tout d’abord, mais également le plaisir causé par le fait qu’un acte aussi anodin puisse être la source d’autant d’énervement.
[3] Ainsi qu’on le verra dans la suite de l’article, le maintien du terme entre guillemets est ici justifié par le fait qu’il est ici analysé en tant que représentation des acteurs sociaux, et indépendamment de la question de sa portée heuristique ou non. En effet il s’agit ici de comprendre ce que fait le néologisme « wokisme », pas de trancher le sujet de sa légitimité.
[4] Pierre Valentin est titulaire d’un master de droit préparé à l’université Paris II-Assas.
[5] On notera aux côtés d’un considérable nombre d’articles de journaux, le travail de Bock-Côté, 2021, Couturier, 2021, Toulouse, 2022, ou de Guigné, 2022, auxquels s’ajoutera prochainement celui de Braunstein, 2022, et la traduction de Lindsay et Pluckrose, 2021.
[6] Sans réaliser un état des lieux exhaustifs, il est possible de noter quelques mentions honorables (Bock-Côté, 2021 ; Couturier, 2021 ; Khan, 2021 ; Mabrouk, 2021 ; Pluckrose et Lindsay, 2021).
[7] En référence à l’expression popularisée à partir du titre de Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media coécrit par Edward Herman et Noam Chomsky (1988).
[8] Ainsi l’usage de l’écriture inclusive a été successivement la marque de « l’idéologie du genre », puis du « communautarisme », présenté comme exemple de la réalité de « l’islamo-gauchisme », avant de devenir un avatar du « wokisme ». Les auspices ne sont pas encore fixés quant au fait de savoir si elle sera ensuite plutôt mobilisée comme preuve de la réalité des dangers du « transactivisme » ou plutôt de la « théorie critique de la race ».
[9] A titre d’exemple, le premier article en sociologie critique de la race ressortant selon cette méthodologie est titré « Les races de poules ».
[10] Autre expression à l’étymologie contestée, la « cancel culture » est employée pour décrire des processus d’ostracisation ayant pour but ou pour effet de réprimer certaines opinions – généralement conservatrices – par des sanctions sociales. Durant la séquence conduisant à la lettre de Harper’s Magazine, la « cancel culture » a été fréquemment décrite comme une pathologie touchant particulièrement la gauche.
[11] Les manifestations de 2020 ont en effet été marquées par des déboulonnages de statues, et des débats autour de statues avaient eu lieu dans plusieurs pays les années précédentes.
Bibliographie
Benford R.D., Snow D.A., Plouchard N.M., 2012, « Processus de cadrage et mouvements sociaux : présentation et bilan », Politix, n° 99, 3, p. 217.
Bock-Côté M., 2021, La révolution racialiste : et autres virus idéologiques, Paris, Les Presses de la cité, 238 p.
Cohen S., 2011, Folk devils and moral panics: the creation of the Mods and Rockers, Abingdon, Oxon ; New York, Routledge (Routledge classics), 282 p.
Couturier B., 2021a, Ok millennials ! puritanisme, victimisation, identitarisme, censure, l’enquête d’un baby-boomer sur les mythes de la génération woke, Paris, Éditions de l’Observatoire, 336 p.
Gautier C., Zancarini-Fournel M. (dir.), 2022, De la défense des savoirs critiques. Quand le pouvoir s’en prend à l’autonomie de la recherche, Paris : La découverte, 269 p.
Goffman E., 1974, Frame analysis: an essay on the organization of experience, New York, Harper & Row, 600 p.
Goode E., Ben-Yehuda N., 2009, Moral panics: the social construction of deviance, 2nd ed, Chichester, U.K. ; Malden, MA, Wiley-Blackwell, 299 p.
Hall S., Critcher C., Jefferson T., Clarke J., Roberts B., 2013, Policing the crisis: mugging, the state, and law and order, Second edition, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 451 p.
Heinich N., 2021, Ce que le militantisme fait à la recherche, Paris, Gallimard, 48 p.
Kuhar, R., Paternotte, D. (dirs.), 2020, Campagnes anti-genre en Europe : des mobilisations contre l’égalité, Presses Universitaires de Lyon, 368 p.
Lukianoff G., Haidt J., 2018, The coddling of the American mind: how good intentions and bad ideas are setting up a generation for failure, New York, Penguin Press, 338 p.
Mathieu L., 2015, « L’ambiguïté sociale des paniques morales », Sens-Dessous, 15, 1, p. 5‑13.
Mohammed M., Talpin J., 2018, Communautarisme?, Première édition, Paris, PUF (La vie des idées), 107 p.
Oliver P.E., Johnston H., 2005, « What a good idea! Ideologies and frames in social movement research », Frames of protest: Social movements and the framing perspective, p. 185‑204.
Pluckrose H., Lindsay J., 2021, Le triomphe des impostures intellectuelles : comment les théories sur l’identité, le genre, la race gangrènent l’université et nuisent à la société, Saint-Martin de Londres, H&O éditions, 448 p.
Salvador X.-L., 2021, « Rapport sur les manifestations idéologiques à l’Université et dans la Recherche », Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires.
Valentin P., 2021a, « L’idéologie woke. 1 : Anatomie du wokisme », Fondation pour l’Innovation Politique.
Valentin P., 2021b, « L’idéologie woke. 2 : Face au wokisme », Fondation pour l’Innovation Politique.